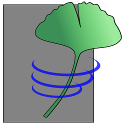Une des phrases du serment du 4ème degré pose la question de l’allégeance. Question qui est connue pour soulever chez les nouveaux Maîtres Secrets de nombreuses interrogations, voire parfois des incompréhensions qu’il convient de ne pas balayer sous le tapis mais au contraire d’analyser soigneusement.
Le nouveau Maître secret promet et jure:
- Allégeance au Suprême Conseil des Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33ème degré
- Obéissance à ses règlements, statuts, et décrets
Comment concilier ce serment d’allégeance et d’obéissance avec les deux sentences qui ont été énoncées juste avant ?
- Vous n’accepterez aucun idée que vous ne compreniez et ne jugiez vraie.
- N’accordez à qui que ce soit une confiance aveugle, mais écoutez tous les hommes avec attention et déférence.
Tout d’abord, notons qu’un serment n’est jamais le signe d’une confiance réciproque, bien au contraire. Si je vous demandais de jurer sur la Bible, par écrit et devant témoins qu’il n’y a pas de poison dans le verre que vous venez de me verser, vous seriez en droit de penser que je ne vous fais pas confiance. Si j’avais confiance en vous, pourquoi vous demanderais-je un tel serment?
Prenons maintenant le temps de bien peser les termes de ce serment.
Il est question d’allégeance au Suprême Conseil. Pas d’allégeance à l’un ou l’autre de ses membres, non, il s’agit du Suprême Conseil dans son ensemble, en tant que collectif. De même, il n’est pas demandé d’obéir aux membres de ce conseil mais à ses règlements, statuts et décrets. L’allégeance et l’obéissance sont deux choses très différentes.
Il ne nous est pas demandé d’obéir aux ordres et encore moins aux souhaits de tel ou tel responsable, comme ce pourrait être le cas dans une armée ou dans une entreprise commerciale. Non, nous n’avons juré d’obéir qu’aux règlements et statuts, tels qu’ils nous ont été communiqués par écrit lors de notre entrée dans la juridiction, ainsi qu’aux éventuels décrets qui pourraient être pris par la suite. De tels décrets, toujours communiqués par écrit et contresignés par plusieurs membres du Suprême Conseil, en leurs qualités, sont en fait assez rares. Quelques-un chaque année tout au plus, et le plus souvent sur des sujets très techniques.
On ne nous demande par ailleurs pas de les applaudir, de les approuver ni même de les juger judicieux, ces règlements et décrets, seulement de leur obéir. Il n’y a là aucune contradiction avec les sentences énoncées lors de la cérémonie. Notre liberté de conscience et d’opinion reste totale.
- Vous n’accepterez aucun idée que vous ne compreniez et ne jugiez vraie.
- N’accordez à qui que ce soit une confiance aveugle, mais écoutez tous les hommes avec attention et déférence?
Cette situation a un avantage pratique: Autant nous sommes co-responsables des décisions et des évolutions de notre Obédience, en tant que Maîtres Maçons d’une Loge représentée au Convent par son député, autant, dans la Juridiction, nous n’avons pas à nous soucier de ces décisions et évolutions.
Nous sommes parfaitement libres et les approuver ou pas, de les trouver judicieuses ou pas, ce n’est en fait tout simplement pas notre responsabilité, tout au moins tant que nous n’avons pas atteint les ultimes degrés qu’on appelait autrefois « administratifs » et qu’on nomme désormais « ultimes vaillances ». Nous ne sommes pas entrés dans la Juridiction pour prétendre l’organiser et encore moins pour nous poser en guides de nos Frères alors que nous n’en sommes qu’au tout début de notre chemin, mais seulement pour y bénéficier d’un cadre propice à la poursuite de notre quête initiatique.
Passons maintenant à une réflexion moins juridique et plus symbolique.
Un ordre initiatique n’est pas une secte religieuse. Le disciple oriental totalement dévoué à son gourou auquel il accorde une confiance aveugle peut être dans une démarche spirituelle de haute valeur, mais il n’est pas dans ce que nous appelons en Europe, depuis près de 2 siècles, une « démarche initiatique ».
A l’inverse, Ulysse, Persée, Œdipe, Jason ou Gilgamesh dans leurs aventures, Dante dans ses voyages ou encore Lancelot dans sa quête du Graal sont bien, eux, dans une quête initiatique au sens que nous donnons habituellement à ce mot.
Une des caractéristiques de la quête initiatique est qu’elle est à la fois personnelle, individuelle et exploratoire. Elle est aussi toujours transgressive car dans une quête initiatique, la Vérité ne se dévoile jamais d’elle-même, elle n’est jamais non plus dévoilée par une autorité supérieure. Elle n’est jamais donnée, il faut oser la conquérir.
Venons-en pour finir aux origines symboliquement chevaleresques de notre serment d’allégeance.
Dans la société féodale, l’allégeance n’est pas l’affaire des roturiers, des vilains ou des serfs. Ceux-là sont tous plus ou moins de condition servile. Les vilains et les serfs peuvent être amenés à servir en tant que soldats en temps de guerre, mais il ne prêtent aucun serment. Ils obéissent aux ordres de leur seigneur, un point c’est tout et sinon gare à eux.
L’allégeance n’est pas l’affaire d’hommes du peuple, c’est une affaire d’hommes libres, autrement dit de membres de la noblesse, au minimum chevaliers. Et c’est une affaire avant tout de convention, de droit et de symbolique, car il n’est pas rare que le vassal soit, dans les faits, beaucoup plus puissant que son suzerain. On se souviendra par exemple du cas des ducs de Normandie ou de Bourgogne, dont tout le monde sait qu’ils furent à certaines époques beaucoup plus riches et puissants que leur suzerain, le roi de France.
A quoi correspondait leur serment d’allégeance? A une organisation essentielle des solidarités entre les puissants du Moyen-Âge. L’allégeance est une affaire de grands seigneurs.
En prêtant allégeance à son suzerain, le vassal allège le fardeau du suzerain puisqu’il promet de l’assister militairement en cas d’agression extérieure. C’est donc bien le vassal qui allège le fardeau du suzerain et non pas le contraire. En contre-partie de cette promesse d’assistance militaire en cas de nécessité, le vassal est reconnu comme titulaire d’un fief, c’est à dire d’un territoire qu’il pourra gérer à peu près comme il l’entend, avec un très grand degré de souveraineté, y compris le droit de basse et de haute justice.
L’allégeance féodale n’était donc pas une soumission à une autorité doctrinale, politique, militaire ou religieuse quelle qu’elle fut. C’était au contraire un engagement de solidarité en échange duquel le collectif de la haute société féodale conférait à un homme libre, l’un des leurs, un noble et pas un roturier, un domaine réservé et des privilèges importants.
Au 4ème degré, nous ne sommes pas encore des chevaliers, mais ça ne saurait tarder et c’est dans cette perspective que nous avons déjà été couronnés de laurier et d’olivier, dans l’espérance de nos succès futurs.
Il semble donc indispensable de bien garder en mémoire tous ces éléments historiques, juridiques et symboliques pour ne pas commettre de contresens sur la signification initiatique profonde de notre serment d’allégeance.