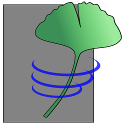(Texte de Brad Warner, mars 2020, traduit par Yudo sur le forum « zen et vous ».
«Je veux étudier la doctrine du non-soi. Mais d’abord, je veux que vous écoutiez toute mon histoire personnelle.»
C’est ce que j’ai dit (plus ou moins) à tous mes maîtres zen. Ils m’ont poliment écouté parler, parler, parler de ma vie. Parfois peut-être, ils acquiesçaient de la tête, ou disaient: « Ah bon? » ou « Quel dommage! » une fois de temps à autre. A l’époque, je ne comprenais pas qu’ils attendaient que je la ferme pour qu’enfin soit possible une interaction.
Mais j’étais bien trop occupé à parler de moi-même pour que cela puisse arriver.
Je me rappelle encore certaines des pensées qui me venaient quand je pratiquais avec Nishijima rôshi. Je ressortais d’une conversation insatisfaisante avec lui, et me disais: « Ah, un vieux Japonais, il est impossible qu’il comprenne ce qui m’arrive. Les gens de son âge n’ont aucune idée de combien les temps ont pu changer. En plus, il ne saura jamais ce que c’est qu’être un travailleur étranger au Japon, et tout ce qu’il faut que je supporte. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Bref, mon ego était froissé parce que mon maître n’était pas arrivé à reconnaître que j’étais quelqu’un de spécial. Je voulais qu’il me voie. Je voulais être reconnu. Mais il refusait, et cela me mettait hors de moi. Et c’était de sa faute si j’étais en colère. S’il m’avait mieux traité, je n’aurais pas été si fâché. Bon, qu’il aille se faire voir!
J’étais bien trop solitaire pour pouvoir me joindre à d’autres personnes comme moi pour me plaindre de la façon dont mon maitre avait rejeté mes besoins. Il n’y avait pas Internet pour trouver des gens qui m’auraient validé mon sentiment.
A l’époque, c’était dur — solitaire, aussi. Mais en rétrospective, je pense qu’il valait mieux. Parce que si j’avais pu trouver quelqu’un pour me conforter, je ne suis pas sûr que j’aurais fait le point sur moi-même et me serais demandé si, peut-être, le problème n’était pas moi.
Aujourd’hui, j’ai échangé les positions. C’est moi, maintenant, qui suis assis à écouter des gens radoter sur eux-mêmes — à quémander une validation personnelle sans comprendre ce qu’ils sont en train de faire, à me supplier de faire l’exact contraire de ce pour quoi ils sont venus me voir.
Certains se fâchent quand je manque à les voir correctement. Ils passent parfois leur colère directement sur moi. Ou parfois sur les média sociaux en écoutant ceux de leurs followers qui leur confirment qu’ils ont raison de penser ce qu’ils pensent de moi. Fort heureusement, il est rare que je voie ça, mais cela arrive. Et quand je vois ça, ça m’agace toujours un peu. Mais encore une fois, ce sentiment d’agacement n’est que mon propre égo froissé, comme j’ai froissé le leur. D’autre part, je sais ce que c’est, j’ai déjà été à leur place.
Nishijima Roshi, comme la plupart des Japonais, ne parlait guère de sa vie personnelle. En fait, et en tant que Japonais, et en tant que personne zen, cette “intersection” (comme disent les jeunes aujourd’hui) le rendait encore plus discret sur sa vie personnelle que la plupart des Japonais. Mais en le fréquentant, j’ai ramassé des miettes et des indices.
Il avait trois ou quatre petits totems sur une de ses étagères. On aurait dit des pierres tombales japonaises miniatures. Un jour je lui ai posé la question, et il m’a dit que c’était pour les enfants qu’il avait perdu. Pour autant que je sache, il n’a jamais eu qu’une seule fille. Il n’a jamais rien dit de plus sur ces autres enfants.
Il avait été conscrit dans l’Armée Impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait dû avoir peur pour sa vie, lorsqu’ils l’avaient appelé. Deux ans plus tard, il fut l’un des chanceux à être revenus. Il revint pour trouver son pays essentiellement rasé, en partie irradié.
Combien de ses amis et de sa famille étaient morts dans cette guerre? Il ne l’a jamais dit. Nous les Américains adorons partager nos histoires de bien moins comment nous nous débrouillons avec le stress post-traumatique que sur ce que nous avons vu et enduré. Je sais que c’est le cas, parce que je l’ai fait. En fait, je l’ai fait avec lui.
Quand je repense à ces petits totems sur son étagère, je repense à tout cela. Et je me rappelle ces pensées comme quoi il était impossible qu’il comprenne ce que j’avais traversé. J’ai profondément honte.
Après quoi, j’ai cessé d’essayer de l’amener à me comprendre. A la place, j’ai essayé de voir ce qu’il voyait. Il avait presque 50 ans, l’année de ma naissance. Le monde entier était devenu fou furieux quand il avait l’âge de mes pires tourments à tenter de trouver un boulot et de gérer mes problèmes de relations sociales. Oh, et de regarder lentement mourir ma mère d’une maladie générique que j’avais 50% de risque d’hériter, quelques années plus tard. Je vivais avec ça aussi.
Et pourtant, en dépit de toutes les choses que mon maître avait vues, et auxquelles il avait survécu, il n’a jamais joué le jeu d’essayer de hiérarchiser nos souffrances sur une sorte d’échelle. Il aurait pu m’arrêter net au cours de n’importe laquelle de mes diatribes et me raconter de ses mésaventures qui auraient fait paraître mes malheurs faibles et triviaux en comparaison. Mais non, jamais.
C’est ainsi que j’ai appris qu’on ne peut pas comparer la souffrance. Pour une personne qui souffre la pire expérience de sa vie, cette souffrance est réelle. Même si, pour moi, ce qu’ils vivent n’a l’air de rien. De plus, ce que les gens vous racontent de leur souffrance n’est souvent qu’un abrégé d’un paquet d’autres choses qu’ils ne vous disent jamais — et qu’ils ne pourraient peut-être même pas raconter eux-mêmes. Je ne saurai jamais vraiment la profondeur de la souffrance d’autrui, peu importe ce qui l’occasionne.
C’est pourquoi je n’essaie pas de mesurer la souffrance de personne d’autre. Ça, plus un entendement qui point en moi depuis plusieurs décennies — la souffrance de chaque individu est aussi la mienne, en fait.
Assis en zazen, en silence, dans des temples à la chaleur étouffante, ou sur des planchers congelés, j’observais les parties de mon histoire personnelle de souffrance se présenter d’elles-mêmes. Parfois sous la forme d’un fouillis kaléidoscopique. Que des formes et des couleurs informes, en mutation devant moi. Parfois claires comme du cristal. Des incidents que j’avais enfouis. Des mots que j’aurais dû dire. Des choses que j’aurais dû faire. Les mots que j’aurais dû ne jamais dire. Des choses dont je n’aurais même pas dû penser de faire, mais que j’avais faites quand même.
Et pourtant, mon maître n’a jamais montré grand intérêt pour rien de tout ça. Au lieu de le critiquer dans ma tête pour ne m’avoir pas vu comme je voulais qu’il me voie, je me suis mis à me demander pourquoi diable n’était-il jamais intéressé. Parce que je pouvais voir qu’il m’avait profondément à coeur, et qu’il se souciait de moi. Mais comment pouvait-il se soucier de moi s’il ne connaissait pas mon histoire? Pourquoi se soucier de quelqu’un qu’il connaissait si peu?
Et pourquoi me souciais-je de lui alors qu’il n’a jamais partagé le moindre détail de sa vie personnelle avec moi? Quelle sorte de relation était-ce là? Cela ne ressemblait à aucune des autres relations que j’avais connues.
Qu’est-ce donc que nous partagions?
La réponse était stupidement évidente.
Nous nous étions tous deux donnés à cette étrange pratique de nous asseoir très, très immobiles en permettant à la vie de se présenter elle-même. Peu de gens sont désireux de faire cela. En particulier quand il s’agit de passer des années à ce qui, pour les gens ordinaires, paraîtrait la chose la plus inutile au monde. Ce que c’est, évidemment.
Il devait chérir quiconque partageait ce profond intérêt dans une chose aussi peu commune. C’est peut-être là que je pouvais le croiser.
Quand j’ai essayé de l’y rencontrer, c’est là que tout a changé.